Depuis quelques années, les perturbateurs endocriniens font de plus en plus polémique et reviennent de plus en plus régulièrement dans l’actualité.
Ainsi, les membres de la Commission Technique de l’association Cosmébio vous proposent un décryptage complet de ces substances qui sont aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique.
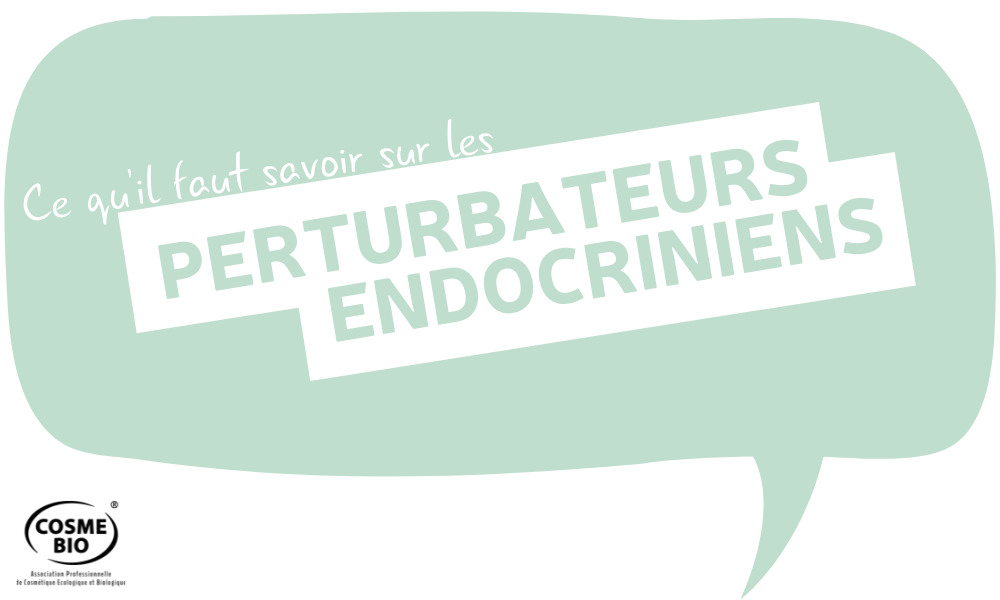
Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ?
Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui perturbent le fonctionnement normal du système hormonal de nombreuses espèces (dont l’homme). Ces molécules peuvent-être d’origine naturelle (ex : phyto-œstrogène) ou synthétique (ex : bisphénol A, les alkylphénols, phtalates, les composés polychlorés).
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2012) : « Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances, qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de (sous)-populations ».
Comment agissent les perturbateurs endocriniens ?
Notre corps sécrète des hormones qui vont permettre différentes fonctions essentielles à notre santé et à notre développement (croissance, reproduction, développement,).
La particularité de ces substances est qu’elles dérèglent notre système hormonale (l’hypothalamus, l’hypophyse, la thyroïde, les glandes surrénales, le pancréas, les testicules et les ovaires) et créent ainsi un déséquilibre qui peut se refléter sur notre santé (obésité, diabète, infertilité,).
Ces substances agissent sur nos hormones et nos organes de 3 manières différentes :
L’effet mimétique :
Les perturbateurs endocriniens imitent l’action d’une hormone naturelle pour prendre sa place
L’effet de blocage :
Les perturbateurs endocriniens empêchent l’hormone naturelle d’agir en se fixant sur les récepteurs avec lesquels elles interagissent habituellement.
L’effet perturbant :
Les perturbateurs endocriniens modifient les effets d’une hormone ou sa circulation dans l’organisme.
Pourquoi les perturbateurs endocriniens sont dangereux ?
Les perturbateurs endocriniens présentent des particularités qui les rendent difficiles à encadrer :
- Des études ont prouvé que même à très faibles doses, ils peuvent être néfastes pour la santé. De même, ils peuvent présenter un effet toxique non proportionnel à la concentration : certains peuvent être plus toxiques à faibles doses qu’à fortes doses.
- Les effets cocktails ne sont pas très bien connus : l’exposition à un mélange de perturbateurs endocriniens pourrait avoir un effet différent de l’exposition aux substances seules. (Les effets peuvent s’additionner, se renforcer ou s’inhiber).
- Notre sensibilité aux perturbateurs endocriniens peut varier selon la période de la vie (la période prénatale, l’enfance, la prépuberté, les femmes allaitantes, …).
- Les effets sur la descendance peuvent se manifester sur plusieurs générations.

Où trouve-t-on les perturbateurs endocriniens ?
Les perturbateurs endocriniens nous entourent : ils peuvent se retrouver dans l’eau, dans l’air, dans les aliments ou encore dans les produits que nous consommons.
Comment sommes-nous exposés aux perturbateurs endocriniens ?
Par voie orale
Nourriture, boisson, médicament, rouge à lèvres, …
Par inhalation
Air pollué, poussiéreux, …
Par voie cutanée
Ces substances peuvent passer la barrière cutanée.
Quel est le cadre réglementaire concernant les perturbateurs endocriniens ?
Réglementation des perturbateurs endocriniens au niveau Européen
A ce jour, il n’existe aucune réglementation spécifique applicable aux perturbateurs endocriniens en raison de l’absence de définition réglementaire commune et officielle à l’ensemble de la législation européenne.
Cependant, la Commission Européenne a tout de même intégré dans certaines réglementations européennes cette notion de perturbation endocrinienne pour les encadrer :
- Le règlement REACH (CE n°1907/2006) : prévoit que les substances possédant des propriétés de perturbation endocrinienne et « présentant un niveau de préoccupation équivalent aux substances CMR (cancérigène–mutagène–toxique pour la reproduction) », puissent être identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes, et ainsi être inscrites sur la liste des substances soumises à autorisation.
- Le règlement sur les produits biocides (CE n°528/2012) et phytopharmaceutiques (CE n°1107/2009) pour lesquels des critères réglementaires ont été adoptés tout récemment (respectivement le règlement n°2017/2100 du 4 septembre 2017 et le règlement 2018/605 de la commission du 19 avril 2018). Ces règlements conduisent à exclure les substances évaluées comme étant des perturbateurs endocriniens.
- Le règlement européen CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges) prévoit d’inclure une définition des perturbateurs endocriniens et de créer deux catégories de danger pour les perturbateurs endocriniens
La définition réglementaire en cosmétique n’a pas encore été définie mais des réflexions sont en cours.
Réglementation des perturbateurs endocriniens en France
Au niveau national, la France a mis en place dès 2014, une stratégie de recherche sur le sujet : la SNPE (stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens) avec pour objectif de diminuer l’exposition de la population et de l’environnement aux perturbateurs endocriniens.
En 2018 la SNPE2 a été annoncée par le gouvernement pour la période 2019-2022 avec pour objectif notamment la protection de la population et de l’environnement en établissant une liste des substances qui peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne.
En lien avec la stratégie nationale, la loi AGEC a introduit une obligation d’information de la présence de perturbateurs endocriniens avérés ou présumés dans les formules et emballages de certaines catégories de produits (dont les cosmétiques). Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour une mise en application prévue courant septembre 2022. Les modalités d’application sont fixées par le décret n°2021-1110 du 23 aout 2021. L'arrêté ministériel a été publié le 28 septembre 2023 pour fixer la liste des perturbateurs endocriniens avérés présumés et suspectés ainsi qu’une liste des catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier.
Dans cet arrêté, aucun des ingrédients autorisés dans les cosmétiques bio n'est mentionné. Pour résumer :
- 128 substances citées
- 13 substances déjà interdites en cosmétiques
- 3 substances potentiellement intégrées dans les formules cosmétiques non certifiées
- 0 autorisées par notre référentiel ✊
Existe-t-il une liste de perturbateurs endocriniens ?
Dans le cadre de la stratégie nationale, l’ANSES a identifié une liste de 906 substances [1] à évaluer du fait de leur activité endocrinienne potentielle et a développé une méthodologie d’évaluation du caractère perturbateur endocrinien des substances chimiques en vue d’un classement en catégories « avérées, présumées, suspectées ». De cette liste, l’ANSES a retenu 16 substances qu’elle juge prioritaire à évaluer.
A l’initiative de cinq autorités nationales de l’Union Européenne (France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Suède), le site edlists.org, mis en ligne 2 juin 2020, répertorie trois listes de substances :
o Liste I
Substances identifiées comme perturbateurs endocriniens au niveau de l’UE
o Liste II
Substances en cours d’évaluation pour la perturbation endocrinienne en vertu d’une législation de l’UE (incluses dans le CoRAP). Parmi ces substances on va retrouver
o Liste III
Substances considérées, par l’autorité nationale d’évaluation, comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne
Remarque : Parmi les substances présentes en liste II on retrouve le benzyl salicylate et l’acide salicylique qui sont utilisés en cosmétique bio.
Comment limiter l’exposition quotidienne aux perturbateurs endocriniens ?
Supprimer les perturbateurs endocriniens de notre quotidien est impossible mais il est tout de même possible de limiter notre exposition.
Si on s’intéresse plus particulièrement aux produits cosmétiques, il est préférable de se tourner vers des produits cosmétiques labellisés Cosmébio qui permettent de limiter de manière non négligeable notre exposition aux perturbateurs endocriniens.
En 2016, des chercheurs de l'université de Berkeley et de la Clinica de Salud del Valle de Salinas en Californie ont lancé une étude chez une centaine d'adolescentes [2], qui a permis de démontrer que l'utilisation de cosmétiques bio permettait de réduire la quantité de produits chimiques de synthèse contenant des perturbateurs endocriniens retrouvés dans l’organisme.
Sources :
[1] https://www.anses.fr/fr/system/files/REACH2019SA0179Anx-1.xlsx
[2] Kim G. Harley,Reducing Phthalate, Paraben, and Phenol Exposure from Personal Care Products in Adolescent Girls: Findings from the HERMOSA Intervention Study, 2016



